

Les 14 janvier et 9 février 2023


Les 14 janvier et 9 février 2023

Située à l’extrême sud-est de la Vendée, la commune de Faymoreau est bordée par la rivière Vendée. Depuis l’an 1003 et jusqu’au milieu du XIIIe siècle, ses terres appartien-nent aux plus grands seigneurs du Poitou. La cité est alors connue pour ses moulins à eau et à vent particulièrement actifs. Mais le destin de Faymoreau bascule un jour de 1827, quand Jean Aubineau, modeste sabotier, découvre une veine de charbon en creusant un puits. Cette découverte entraîne, à deux kilomètres du bourg, la construction puis le développement de la cité minière. Le bâti du nouveau village de La Verrerie répond alors aux exigences de la Société des Mines : corons, direction, chapelle, écoles… Des gens d’ici et d’ailleurs arrivent dans le bassin minier. Faymoreau devient alors une cité ouvrière. Des entreprises telles que la verrerie, qui produit un million de bouteilles par an, des cloches de jardin et des bocaux, ainsi que la centrale électrique, voient le jour pour consommer une grande partie du charbon extrait. Le 28 février 1958, la mine ferme définitivement.
Les corons sont encore habités et les jardins ouvriers cultivés, les vitraux de Carmelo Zagari illuminent la Chapelle, le musée situé dans l’ancien dortoir des verriers fait ressurgir le glorieux passé industriel. Le bourg historique, quant à lui, est constitué de maisons d’habitation, de l’église paroissiale et du château.
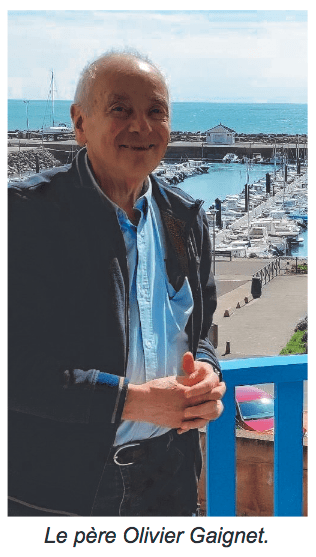
Vous connaissez sans doute ce conte amérindien: «Le vieillard dit à l’enfant: «Il y a deux loups en toi. Un loup blanc, bienveillant, et un loup noir cruel. Ils vont se mesurer l’un à l’autre. Sais-tu lequel va l’emporter? Celui que tu auras nourri!»
De même aujourd’hui, en ce monde qui est notre «maison commune»,on constate chaque jour ce combat entre l’égoïsme et le souci des autres, entre une humanité qui travaille au bien commun et une autre qui se l’accapare. De quel côté nous situons-nous ?
Heureusement, au cœur de cette crise, n’ont cessé de s’épanouir les fleurs du printemps! Cette pandémie, le confinement nous ont obligés à faire notre examen de conscience; en nous mettant en arrêt, et le couvre-feu y a contribué, nous avons commencé à envisager notre vie autrement, sur des valeurs plus vraies.
L’envol vers le ciel de Thomas Pesquet a contribué largement à élever notre cœur, car il a invité l’ensemble de notre nation et de l’humanité à regarder enfin vers le haut et à rêver d’Infini.
À n’en pas douter, cette année 2020 restera dans chacune de nos mémoires et entrera probablement dans l’Histoire, tant la situation que nous venons et continuons de vivre est inédite.
En ce XXIe siècle hyper connecté, alors que la science et la technologie semblaient devoir tout résoudre, voilà qu’un microscopique virus vient frapper et paralyser la planète entière engendrant une grave crise sanitaire aux lourdes con-séquences humaines, économiques et sociales.
Bien sûr, nos pensées vont d’abord aux nombreuses victimes de cette pandémie, à leur famille. Pour notre assemblée départementale il convient aussi de saluer la mémoire de notre ancien collègue, conseiller général et sénateur honoraire, Jacques Oudin, qui a tant œuvré pour la Vendée et pour son île, emporté brutalement au début de la pandémie.
Face à cette crise sans précédent et dans l’urgence, le conseil départemental, chef de file des solidarités tant auprès des familles que des personnes âgées ou en situation de handicap, de celles en parcours d’insertion, s’est efforcé d’être au plus près des Vendéennes et des Vendéens et notamment des plus fragiles.
Dans un contexte particulier : en télétravail, par téléphone, en visioconférence, puis plus tard en présentiel dans le respect des mesures de sécurité sanitaire, élus et agents du département ont œuvré au quotidien pour assurer la continuité de service et répondre aux besoins des populations.
Lire la suite en téléchargeant la lettre d’information N°2 de l’année 2020
 En près de quarante ans, l’informatique a envahi nos vies. Tout d’abord réservé aux grandes entreprises, l’outil numérique s’est progressivement installé dans toutes les PME, puis a continué sa course pour venir occuper notre espace personnel: nos bureaux, puis nos salons, nos poches avec nos smartphones, nos poignets avec la montre connectée et notre espace sonore avec les assistants vocaux…
En près de quarante ans, l’informatique a envahi nos vies. Tout d’abord réservé aux grandes entreprises, l’outil numérique s’est progressivement installé dans toutes les PME, puis a continué sa course pour venir occuper notre espace personnel: nos bureaux, puis nos salons, nos poches avec nos smartphones, nos poignets avec la montre connectée et notre espace sonore avec les assistants vocaux…
Bientôt, comme on le voit apparaître, nos corps seront augmentés de nanopuces, dans une vision du transhumanisme activement promue par les grands groupes technologiques américains et chinois.Ultime développement, le numérique s’installe également progressivement dans l’espace public. C’est la ville connectée ou le territoire intelligent, avec ses caméras, ses capteurs, compteurs, détecteurs, interfaces tactiles, affichages numériques,… Ces équipements, qui se trouvent parfois dans des endroits que l’on ne pourrait soupçonner, apportent à la puissance publique des auxiliaires à la décision, une meilleure efficacité de gestion ou tout simplement une aide très pratique au quotidien.
Lire l’édito complet dans la lettre N°1 de 2020
Emmanuel CHOPOT
Président de Vendée Réseaux Sociaux
Fondateur de MyStoriz
 Extrait de l’éditorial de la lettre de l’AVQV de juin 2019 par le Dr Jacques Berruchon.
Extrait de l’éditorial de la lettre de l’AVQV de juin 2019 par le Dr Jacques Berruchon.
« Voici quelques mois a été découvert un fragment manuscrit oublié du Gargantua de Rabelais. D’après ce texte, jamais édité, le bon Géant s’empare aux dépends d’un navire espagnol d’une cargaison de ce tabac que Christophe Colomb venait juste d’introduire dans le Vieux Monde. Ses serviteurs lui confectionnent un énorme cigare qu’il fume avec plaisir, assis sur les tours de Notre-Dame. Il veut, par pure bonté d’âme, en faire profiter les Parisiens. S’approchant d’une grande cheminée, il inspire profondément la fumée du cigare et l’insuffle de toutes ses forces. Elle ressort par les fenêtres et les portes et avec elle les habitants qui titubent avant de s’écrouler mourants sur la rue.
Les porcs, les mouches et même l’herbe meurent aussi. Déçu, Gargantua éteint son cigare de la façon que l’on sait en noyant quelques survivants. Rabelais n’a jamais osé publier ce haut fait (presque) véridique.
Car nous savons aujourd’hui que cet enfumage massif possédait toutes les qualités pour faire un grand nombre de victimes. Les éléments nocifs de la fumée de tabac au nombre de 1800 sont connus pour être cancérigènes, irritants ou toxiques. »
 Plusieurs facteurs expliquent cette réussite : des habitants particulièrement soucieux du geste de tri, des collectivités engagées dans la mise à disposition d’outils pour trier
Plusieurs facteurs expliquent cette réussite : des habitants particulièrement soucieux du geste de tri, des collectivités engagées dans la mise à disposition d’outils pour trierPlus facile à dire qu’à mettre en pratique n’est-ce pas ?
De nombreux titres de publications reprennent cette expression qui, d’ailleurs, revient très souvent dans notre parler quotidien. Mais vivre ensemble ne va malheureusement pas de soi et nous devenons peut-être sans nous en apercevoir de plus en plus intolérants vis-à-vis de nos concitoyens.
C’est pourquoi aujourd’hui, je voudrais saluer l’initiative d’une petite commune rurale du Doubs (818 habitants en 2017), Guyans-Vennes, commune certes pas vendéenne, mais dont l’initiative me paraît être un exemple à suivre.
En 2015, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), cette commune a décidé de rédiger une « Charte du Nouvel Arrivant, pour bien vivre en milieu rural ».
Dans un premier temps, l’objectif de celle-ci est d’informer tous les nouveaux dépositaires d’un permis de construire sur le lotissement des Ménonts en cours de réalisation et d’accepter les éventuelles nuisances provoquées par la présence du centre de tirs d’un armurier et de l’exploitation d’une carrière.
Le conseil municipal évoque cette charte et décide de l’étendre à l’ensemble des permis de construire déposés sur le territoire de la commune afin de tenir informés les nouveaux habitants de la présence d’éventuelles nuisances liées à la vie d’une commune rurale. Cette charte ne concerne pas uniquement les nouveaux arrivants, elle est diffusée dans tout le village afin de favoriser la cohabitation de la population entre les anciens et les nouveaux. À chacune et à chacun de s’engager moralement pour une vie des plus conviviale.
Cette charte se divise en quatre parties, dont voici l’essentiel :
Adhérents, élus, je vous conseille de vous rendre sur le site officiel de cette commune, où vous pourrez prendre connaissance de l’intégralité de cette charte et même la télécharger et pourquoi pas la diffuser.
Robert AUJARD
Ce passeport du civisme est un document, remis officiellement à chaque enfant de CM1 CM2 volontaire, qui lui permet de valider des actions collectives ou individuelles qu’il doit réaliser. Cette démarche a pour but de le sensibiliser au respect de chacun au sein de la collectivité dans laquelle il vit. Elle a été initiée en 2015 par Maxence de Rugy, maire de Talmont et a été adoptée, pour l’année scolaire 2017-2018 par le conseil municipal du Bernard, commune où je réside.
Les actions retenues ont été les suivantes :
À l’issue de chacune des actions effectuées dans ce cadre, le passeport est validé par un ambassadeur du civisme de la commune, personne choisie pour son dévouement et son engagement dans le domaine concerné.
Personnellement, je suis « co-ambassadeur » pour le devoir de mémoire et la préservation de l’environnement.
Général Jacques de Morant
Notre corps est composé de 60% d’eau, et celle-ci rentre même pour 80% dans la composition de notre sang. C’est dire si l’eau est indispensable à notre existence et l’on ne saurait s’en passer pour la vie courante.
Tourner un robinet pour que l’eau jaillisse nous est devenu un geste naturel mais déjà, dans l’Antiquité,des travaux considérables étaient effectués pour amener l’eau au centre des villes comme en témoignent des aqueducs comme le Pont du Gard ou les Thermes de Caracalla à Rome. Depuis, les techniques ont évolué et l’on ne s’en étonne plus. Avec l’augmentation de la population mondiale et la recherche de meilleures conditions de vie, la demande ne cesse de croître et l’on doit trouver de plus en plus de nouvelles ressources.
Plus de 95% des ressources en eau de la planète sont situées dans les océans, mais cette eau salée n’est que difficilement utilisable pour les besoins humains.
Les ressources en eau douce constituées à 70 % par les glaces polaires et celles des glaciers de montagne sont tout autant peu utilisables. C’est à partir des 30% restants que les besoins en eau doivent être satisfaits avec la répartition ci-dessous :
Ces ressources mondiales sont renouvelées par les précipitations (pluie et neige) évaluées à une hauteur moyenne annuelle dans le monde de 860 millimètres, mais la répartition géographique de ces précipitations dans le monde est très inégale. Il peut tomber jusqu’à 11 m de précipitations au pied de l’Himalaya et 0 m certaines années au Sahara. De même au Brésil, le bassin de l’Amazone reçoit de fortes précipitations alors que les régions plus à l’est souffrent de sécheresse.
L’agriculture, avec l’irrigation, est le plus gros consommateur d’eau douce de la planète (près de 70%), cette part peut même aller jusqu’à 90% dans certains pays producteurs de café ou de coton.
En France, c’est le secteur de l’énergie, avec l’eau de refroidissement des centrales, qui vient en tête de la consommation avec plus de 50%, la production d’eau potable représente environ 20%, suivie de l’irrigation pour l’agriculture, à peu près à égalité avec l’industrie où l’eau est nécessaire pour refroidir, laver…
Dans le monde, l’utilisation domestique représente environ 15% de la consommation d’eau douce, elle varie selon les pays et selon les habitudes de chacun.
La quantité minimale d’eau propre nécessaire serait de 50 litres d’eau par jour par habitant. Mais si un Américain moyen utilise 650 litres d’eau par jour, quantité dont nous nous approchons en France, des millions de personnes vivent ailleurs avec chacune moins de 12 litres d’eau par jour.
On estime qu’il existe encore plus de 50 millions de personnes privées d’eau potable, même si de remarquables progrès ont été effectués dans ce domaine avec des puits, des bornes ou des robinets communs, dont malheureusement l’accès est souvent limité dans le temps. Cette situation entraîne l’exode de populations entières. Le nombre de réfugiés déplacés à cause de l’eau contaminée serait supérieur à celui de personnes réfugiées pour fuir les guerres.
L’approvisionnement en eau de régions entières peut même engendrer des tensions entre États riverains d’un même fleuve. Il en est ainsi pour le Nil, où l’Ethiopie, envisage de construire des dizaines de barrages au détriment des dix autres pays riverains, dont l’Égypte, pour lesquels ce fleuve est une ressource vitale.
L’assainissement de l’eau est un luxe pour beaucoup.Plus d’un milliard d’humains font leurs besoins en plein air et plus de 2 milliards et demi ne sont pas raccordés à un système correct d’assainissement. Inversement en France, les 3/4 de l’eau qui alimente nos toilettes est de l’eau potable rejetée ensuite dans le réseau d’assainissement.
Alors, gardons ces quelques chiffres en mémoire et économisons l’eau en mesurant notre chance :
Général Jacques de Morant